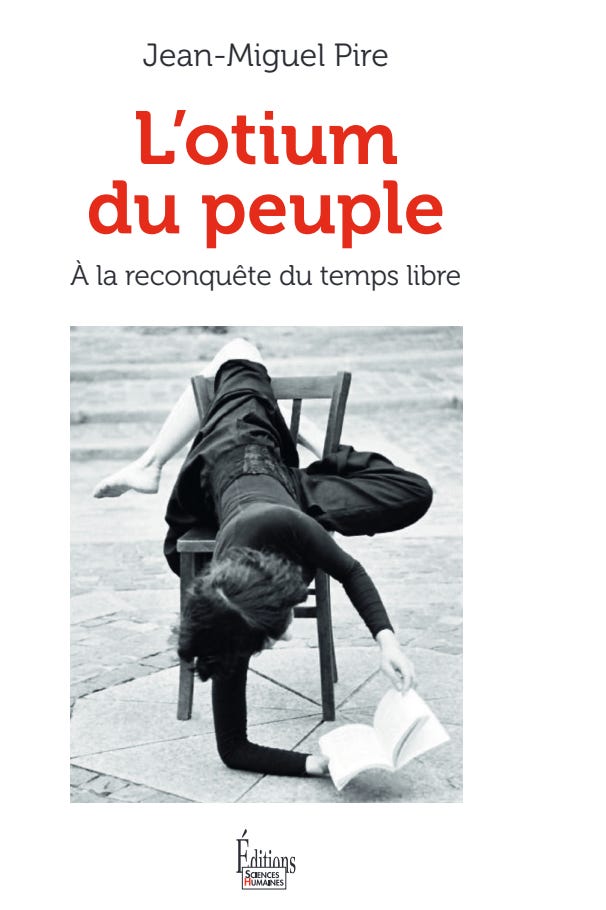👋 Bonjour !
Merci pour vos retours suite au lancement de cette newsletter et bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées !
Je suis vraiment heureuse que la première édition vous ait intéressés et qu’elle ait suscité des réflexions pour vous !
Si vous n’êtes pas encore abonné(e) :
Au programme de cette édition :
On part à la découverte de l’agentivité
… en ajoutant une dose de réflexivité
Je vous propose quelques questions
Et une recommandation pour retrouver le “loisir intelligent”
On y va ! 🔥
Vous pouvez écouter cette newsletter au format audio ici.
A la découverte de l’agentivité
Dans l’édition précédente, je vous ai parlé de mon sujet de recherche : je m’intéresse à la manière dont les récits du travail influencent notre capacité d’agir individuelle et la co-responsabilité collective.
Un des mots-clés de cette recherche, c’est l’agentivité.
L’agentivité, c’est la capacité à être acteur de sa propre vie, à prendre des initiatives et à influencer son environnement. C’est une notion qui m’intéresse particulièrement parce qu’elle nous invite à réfléchir à notre rôle et à notre responsabilité dans le monde. Elle implique une réflexion sur soi, sur son environnement, sur le système dans lequel on évolue. Je l’ai liée à la notion de co-responsabilité car je crois profondément qu’en agissant sur soi avec intention et conscience, on agit autant pour soi que pour le collectif.
C’est un terme relativement peu connu et utilisé. Il est plus courant en anglais (agency). Je l’ai même entendu dans une série américaine la semaine dernière !
On peut imaginer plusieurs raisons à cette discrétion :
c’est un mot plus souvent utilisé dans le domaine académique
il est complexe à saisir
il n’a pas été popularisé dans des contenus grand public
il ne veut pas forcément dire la même chose selon la discipline dans laquelle il est utilisé (en psychologie, on va davantage mettre l’accent sur l’intention alors qu’en sociologie on s’intéressera davantage aux structures sociales et aux dynamiques de pouvoir dans lesquelles l’agentivité peut se déployer)
il continue d’évoluer (et va sans doute continuer encore avec tout le vocabulaire associé aux “agents IA”).
Comment ce mot est-il apparu dans mon champ ?
J’aime bien retracer le chemin des idées, me souvenir du moment où j’ai découvert un mot, un concept, et grâce à qui. Je sens comme une obligation éthique de rendre hommage à celles et ceux qui ont planté ces graines.
Souvent, lorsque je lis ou découvre des idées que je trouve passionnantes et en adéquation totale avec ma vision d’un sujet ou plus largement de la vie, je suis submergée. Par une émotion que j’ai du mal à caractériser. Il s’agit à la fois d’une ivresse intellectuelle, je sens qu’il se passe quelque chose dans mon cerveau, et d’un emballement physique. Mon cœur bat plus fort, mon souffle est en même temps coupé et plus profond. Un tourbillon se crée en moi, j’ai envie de me plonger encore plus éperdument dans le sujet en question, de découvrir toutes ses facettes, de le décortiquer, de l’analyser, de le malaxer, de l’étirer, et d’en tirer mes propres réflexions, entrelacées avec celles de ceux qui ont pensé avant moi. Je crois que c’est cela qui m’émeut le plus. De me dire que nous sommes plusieurs à penser un même sujet, à être d’accord ou pas, à enrichir nos réflexions mutuelles. Cela me connecte au reste de l’humanité. Et me bouleverse. Et c’est pour cela que je veux continuer à partager mes recherches, car peut-être un jour elles contribueront à la réflexion d’une ou plusieurs personnes, et cela nous réjouira et nous connectera.
En l’occurence, ce mot “agentivité”, je me souviens très bien du moment où je l’ai entendu pour la première fois. C’était un webinar sur le sens au travail organisé par la mutuelle Alan en 2022 dans lequel intervenait Laetitia Vitaud dont j’admire beaucoup le travail (et que j’ai eu le plaisir de recevoir deux fois à mon micro !).
Puis il est apparu de nouveau dans les textes et partages de Jérémy Lamri, qui est également passionnant et que j’ai aussi eu la chance d’avoir comme invité.
J’en profite au passage pour vous recommander chaleureusement les épisodes avec Laetitia et Jérémy sur le podcast Work Narratives.
Bref, si ces deux personnes que je trouve particulièrement inspirantes mettent en lumière une notion, c’est qu’elle doit être importante !
J’ai donc commencé à vouloir en savoir plus. Et puis cet été, je lisais le livre The Myth of Normal, du Dr. Gabor Maté, et l’agency fait partie des principes qui selon lui mènent à la guérison dans le domaine de la santé.
“Agency is the capacity to freely take responsibility for our existence, exercising "response ability" in all essential decisions that affect our lives, to every extent possible. Being deprived of agency is a source of stress. Such deprivation could arise from social or political conditions: poverty, injustice, marginalization, or the seeming collapse of the world around us. In the case of illness, it's often due to internal constraints. (…) The exercise of agency is powerfully healing.”
Traduction : "L’agentivité est la capacité à assumer librement la responsabilité de notre existence, en exerçant une « capacité de réponse » [ndlt : on perd le jeu de mot avec “responsabilité” / “responsability” en traduisant] dans toutes les décisions essentielles qui affectent nos vies, autant que possible. Être privé d’agentivité est une source de stress. Une telle privation peut résulter de conditions sociales ou politiques : pauvreté, injustice, marginalisation, ou l’effondrement apparent du monde qui nous entoure. Dans le cas de la maladie, elle est souvent due à des contraintes internes. (…) L’exercice de l’agentivité est profondément réparateur.”
Gabor Maté raconte que Kelly Turner, chercheuse spécialisée en oncologie et consultante en médecine intégrative, a étudié de nombreux cas de patients qui avaient réussi à se soigner alors que leur pronostic était plus que mauvais. Tous avaient en commun d’avoir été plus actifs, plus curieux, d’avoir beaucoup questionné leurs médecins, d’avoir cherché des solutions ailleurs, et combiné plusieurs approches.
Comme le souligne Gabor Maté, ne s’agit cependant pas de croire que nous sommes omnipotents et que nous pouvons tout maîtriser.
“Life is so much bigger than us, and we do not forward our own healing by pretending to be in control where we’re not”.
Traduction : "La vie est tellement plus grande que nous, et nous ne favorisons pas notre guérison en prétendant avoir le contrôle là où nous ne l'avons pas".
La théorie de l'agentivité en trois dimensions
En démarrant mon projet de mémoire, j’ai découvert les travaux de Mustafa Emirbayer et Ann Mische (What is agency? publié dans American Journal of Sociology, Vol. 103, No. 4 (January 1998), pp. 962-1023).
Emirbayer et Mische proposent une vision de l'agentivité qui se compose de trois dimensions temporelles :
Le passé : La dimension itérative
C'est notre tendance à répéter des schémas de pensée et d'action du passé.
Par exemple, nos habitudes et routines.
Le futur : La dimension projective
C'est notre capacité à imaginer des possibilités futures.
Par exemple, nos rêves, nos projets et nos aspirations.
Le présent : La dimension pratique-évaluative
C'est notre aptitude à prendre des décisions dans l'instant présent.
Par exemple, réagir à une situation inattendue.
Comment ça fonctionne ?
On peut imaginer ces trois dimensions comme les cordes d'un instrument de musique. Elles sont toujours présentes, mais l'une peut être plus forte que les autres selon la situation.
Nos actions sont influencées par nos expériences passées.
Elles sont guidées par nos projets futurs.
Et elles sont ajustées en fonction des circonstances présentes.
On peut aussi ajouter à cela la théorie d’Albert Bandura, grand psychologue, qui a développé le concept de sentiment d’efficacité personnelle. Celui-ci désigne la conviction qu’un individu a de sa capacité à accomplir une tâche ou à atteindre un objectif. Ce sentiment joue un rôle clé dans l’agentivité, car plus nous croyons en notre capacité d’action, plus nous sommes enclins à prendre des initiatives et à persévérer face aux obstacles.
L’agentivité ne se résume pas à une simple capacité d’action individuelle, elle est profondément ancrée dans nos contextes sociaux, nos expériences de vie et les structures qui nous entourent. Comme le souligne Gabor Maté, être privé d’agentivité est une source de stress, et pourtant, notre société propose souvent une version biaisée de cette notion : une illusion de choix sans prise en compte des contraintes structurelles. La véritable agentivité implique donc une prise de responsabilité consciente, une capacité à naviguer dans nos propres limites tout en cherchant à les redéfinir.
Ce processus de réappropriation de notre pouvoir décisionnel, lorsqu’il est exercé avec lucidité et authenticité, possède un potentiel profondément guérisseur. Il nous invite à ne plus simplement réagir aux événements, mais à développer une « response flexibility » qu’évoque Gabor Maté, essentielle pour adapter nos actions aux réalités changeantes de notre environnement. En ce sens, cultiver l’agentivité, c’est aussi accepter l’incertitude et apprendre à construire un rapport plus nuancé à notre propre pouvoir d’agir.
Pour exercer une réelle agentivité, nous devons être conscients des marges de manoeuvre que nous avons réellement.
Je vous parlais dans l’édition précédente de réflexivité, le fait d’observer ce que nous faisons et pourquoi, de questionner nos choix. C’est un levier puissant pour développer notre agentivité.
La réflexivité : pourquoi on fait ce que l’on fait
La réflexivité nous invite à un questionnement permanent : pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Quels sont les cadres qui structurent nos pensées et nos actions ? Comment les éléments de notre histoire personnelle influencent-ils notre posture dans le monde ?
Dans la recherche, cette démarche est essentielle pour éviter de reproduire des biais inconscients et pour rendre compte des limites de notre approche. C’est un exercice d’humilité autant que de clarté intellectuelle.
En démarrant mon plongeon épistémologique (raconté dans ce numéro), j’ai vu le parallèle avec la “posture méta” que l’on développe en coaching. Lors d’une séance, cette posture est fondamentale : elle permet d’observer les dynamiques à l’œuvre dans une situation, d’interroger les croyances sous-jacentes et d’accompagner la mise en mouvement vers de nouvelles possibilités. Elle permet de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer, et d’aller un cran plus loin.
Je découvre grâce à l’écriture de cette newsletter que le terme de metacommunication a été introduit en 1935 par l’anthropologue, psychologue et épistémologue américain Gregory Bateson (merci Wikipedia !).
En y réfléchissant, je me suis rendu compte à quel point tout cela était relié : que l’on parle de recherche, d’accompagnement ou de travail collectif, la clé réside dans notre capacité à prendre du recul, à interroger nos schémas et à affiner nos intentions.
En ce qui me concerne, la démarche de réflexion demandée dans la recherche ne peut être pas envisagée sans une profonde introspection et développement de ce qui me constitue et m’anime. J’ai rapidement vu un miroir entre mon sujet et mes propres questionnements : quelle est ma part d’agentivité et de responsabilisation, ma contribution individuelle, pour un impact collectif ? Quelles sont mes réelles marges de manœuvre et l’espace que je peux prendre pour me développer à la fois individuellement et contribuer à plus grand ? Quelle est ma responsabilité ? Comment puis-je m'engager à plus de co-responsabilité ? Quel est le système dans lequel je m’insère ? Comment peut-il évoluer ? Quelle est ma part d’utopisme ? Quelle est ma part d’optimisme ? En quoi ma personnalité va-t-elle impacter mon travail ? Quelle part de liberté puis-je exercer dans mon travail de recherche ?
Ce ne sont évidemment pas des questions auxquelles je peux répondre en un clin d’oeil, mais au fur et à mesure, j’affine mon intention et ma mobilisation dans mes projets. C’est ce qui me permet de faire des choix avec lesquels je suis non seulement alignée, qui me motivent, et dont le but est clair pour moi.
Ma proposition pour vous
La réflexivité joue un rôle crucial dans la théorie de l'agentivité. Elle représente notre capacité à réfléchir sur nos actions, pensées et expériences.
Dans le contexte des trois dimensions temporelles d’Emirbayer et Mische évoquées plus haut :
La réflexivité nous permet de prendre du recul sur nos habitudes passées (dimension itérative) et de les évaluer de manière critique.
Elle aide à imaginer et à affiner les projets futurs (dimension projective) en analysant leur faisabilité et leur désirabilité.
Dans le présent (dimension pratique-évaluative), la réflexivité facilite la prise de décisions éclairées en nous permettant de considérer consciemment les influences du passé et les aspirations futures.
On peut dire que la réflexivité agit comme un "chef d'orchestre" qui harmonise les trois dimensions temporelles de l'agentivité. Elle nous permet de naviguer de manière plus consciente et intentionnelle entre nos expériences passées, nos projections futures et les exigences du présent, renforçant ainsi notre capacité d'agir de manière autonome et réfléchie.
Voici mes questions pour vous aujourd’hui sur ce modèle :
Dimension itérative (passé)
Y a-t-il une habitude ou une façon d’agir que vous avez récemment remise en question en prenant du recul ?
Comment votre passé influence-t-il encore vos choix professionnels aujourd’hui ?
Dimension projective (futur)
Quel projet ou changement aimeriez-vous concrétiser, et comment votre réflexivité vous aide-t-elle à l’affiner ?
Quand vous pensez à votre futur professionnel, quels éléments prenez-vous en compte pour évaluer ce qui est souhaitable et faisable ?
Dimension pratique-évaluative (présent)
Lors d’une prise de décision récente, comment avez-vous concilié votre expérience passée et vos aspirations futures ?
Comment pourriez-vous cultiver davantage de réflexivité dans votre quotidien professionnel ?
Réflexion globale
Vous considérez-vous comme une personne réflexive dans vos choix de carrière et d’organisation du travail ? Pourquoi ?
Quelle est la dernière prise de conscience que vous avez eue sur votre manière de travailler ou d’interagir avec les autres ?
Ma recommandation du jour : L’otium du peuple
La seule manière d’être plus responsables et de pouvoir nous saisir de notre agentivité, c’est de muscler nos connaissances et compréhension du monde. De faire preuve de conscience, recul, de cette fameuse réflexivité.
Particulièrement à l’ère de la post-vérité et de l’IA où ne nous savons plus ce qui est vrai ou faux, nous avons besoin plus que jamais de cultiver notre esprit critique.
Cet été, j’ai dévoré le livre de Jean-Miguel Pire : L’otium du peuple.
L’otium, c’est “le “loisir fécond”, que la pensée antique hissait au sommet des activités humaines”. C’est une manière d’utiliser le temps pour “réfléchir, imaginer, contempler, comprendre”. Jean-Miguel Pire défend sa nécessité pour nous permettre d’être autonomes.
Je prépare un article plus long sur cette ouvrage, je vous en reparlerai donc bientôt, mais j’avais vraiment envie de vous en parler dès aujourd’hui car c’était la recommandation parfaite pour aller avec le sujet de l’agentivité et la réflexivité !
J’avais d’abord entendu Jean-Miguel Pire dans un épisode de Vlan, animé par Grégory Pouy (que j’ai reçu à mon micro pour la première saison de mon podcast, décidément que d’invités cités dans cette édition !). Voici le lien de cet épisode si vous préférez commencer par cette écoute !
Parlons-en !
Qu’avez-vous pensé de ce numéro ?
Cette newsletter est un espace de réflexion et de dialogue. N’hésitez pas à répondre par mail, commentez, partagez vos idées et vos propres récits !
Vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram, et suivre le podcast Work Narratives.
👉 Si on vous a transféré cette édition, inscrivez-vous pour recevoir les prochaines, rejoignez la conversation et réinventons ensemble les récits du travail !
Découvrir mon travail
Mon essai sur Le nouveau récit du travail
Mon podcast Work Narratives
Mes propositions d’accompagnements et de conférences sur mon site www.valentinegatard.com
A bientôt !
Valentine